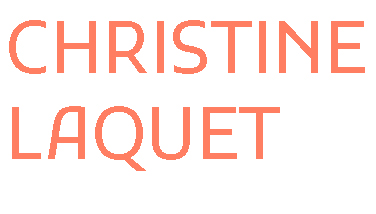Galerie RDV, Nantes.
 Christine Laquet s’intéresse à d’autres façons d’être au monde et de l’habiter. Par la diversité de ses techniques, elle interroge les relations ambiguës que l’homme entretient avec son milieu. Dans l’exposition RE-POSER LA TERRE, l’artiste imagine des processus de co-créations atypiques avec le non-humain qui impliquent des relations plus équilibrées avec le végétal, l’animal ou le minéral. S’inspirant du concept d’une « nature interconnectée » d’Alexander Von Humboldt, son œuvre explore sous l’angle de la métamorphose l’organique et le géologique et imagine des symbioses défiant naturel et synthétique ; une recherche où des éléments hétérogènes s’assemblent, forment un corps hybride provoquant et créant des co-présences et du lien.
Christine Laquet s’intéresse à d’autres façons d’être au monde et de l’habiter. Par la diversité de ses techniques, elle interroge les relations ambiguës que l’homme entretient avec son milieu. Dans l’exposition RE-POSER LA TERRE, l’artiste imagine des processus de co-créations atypiques avec le non-humain qui impliquent des relations plus équilibrées avec le végétal, l’animal ou le minéral. S’inspirant du concept d’une « nature interconnectée » d’Alexander Von Humboldt, son œuvre explore sous l’angle de la métamorphose l’organique et le géologique et imagine des symbioses défiant naturel et synthétique ; une recherche où des éléments hétérogènes s’assemblent, forment un corps hybride provoquant et créant des co-présences et du lien.
Informations pratiques :
Galerie RDV
16 Allée du Commandant Charcot
44000 Nantes
02 40 69 62 35
Du mercredi au samedi 14-19h et sur rendez-vous.
L’exposition fait partie de l’événement WAVE – Week-end arts visuels de Nantes et son agglomération, qui se tiendra du 28 au 30 mai 2021.
Christine Laquet, RE-POSER LA TERRE par Ilan Michel
Il suffit d’un rien pour s’enchanter ou se désenchanter de l’action humaine sur notre planète. Parallèlement au constat d’échec de la Convention Citoyenne pour le climat, des groupes d’habitants réunis autour du sociologue Bruno Latour définissent leurs dépendances à la Terre sous forme de cahiers de doléances pour penser « le monde d’après »[1]. RE-POSER LA TERRE semble à cet égard participer de cette utopie concrète ou tout du moins la développer dans le champ des arts plastiques. En réaction aux interventions brutales du land art dans le paysage, Christine Laquet explore depuis longtemps la porosité entre les êtres et leur milieu. Plus précisément, elle s’intéresse ici à mettre en évidence des généalogies oubliées qui pourraient nous servir de modèles contre la crise environnementale, ce que la philosophe écoféministe Donna Haraway nomme « capitalocène[2] ». En 1804, puis 1866, Friedrich Strass publie une cartographie de l’histoire de l’humanité intitulée Der Strom der Zeiten [Le courant du temps], reproduit ici à l’horizontale, dans un wall-drawing au fusain. Ayant connu une popularité immédiate, donnant lieu à de multiples variations, la chronologie représente chaque grande nation humaine sous la forme d’un fleuve s’écoulant des nuées, de l’Empire Romain à l’assassinat d’Abraham Lincoln. Cette spatialisation du temps à la portée encyclopédique et aux formes tentaculaires, racinaires plus que rhizomiques, tente de traduire une histoire organique dont les événements découlent les uns des autres, sans penser encore les interconnexions. À la même époque, le naturaliste allemand Alexander Von Humboldt va plus loin dans la corrélation entre l’histoire humaine et l’histoire naturelle. Le portrait sur aluminium présent dans la galerie, sur lequel se superposent des extraits de planches gravées, rappelle les plaques utilisées dans le procédé d’impression offset. La presse se fait en effet l’écho des découvertes du naturaliste allemand connu pour son ascension en 1802 du Mont Chimborazo, le plus haut sommet des Andes équatoriennes. Le « Tableau physique » qu’il dresse dans son Essai sur la géographie des plantes (1805) est saisissant : la coupe du volcan fait apparaître la variété des espèces végétales et animales qui s’y développent selon leur altitude, le climat et la topographie du site. Premier « microcosme sur une feuille » (écrit-il au naturaliste Marc Auguste Pictet en 1805), sa description du cosmos mêle les interactions entre les organismes vivants, impliquant l’impact des sociétés sur le milieu naturel – déforestation, irrigation, et pollution industrielle. Les reflets argentés des plaques d’aluminium, métal toxique le plus présent sous terre après le silicium, soulignent ici l’état transitoire des reliefs montagneux extraits des gravures du voyageur. La terre d’ombre brûlée utilisée pour en dessiner les contours réattribue une matière naturelle que la reproduction mécanique a rendu abstraite. Les supports métalliques brillants impliquent autant les spectateurs qu’ils ne déstabilisent leurs images, à l’instar d’un palais des miroirs. Plus qu’un hommage au savant, ce point de départ est l’occasion pour Christine Laquet de développer les contaminations réciproques entre l’humain et le non-humain sous l’angle de la métamorphose. Si à l’heure de la crise écologique la place centrale de l’Homme doit être reconsidérée, RE-POSER LA TERRE compose un environnement « cosmomorphe[3] », qui nous met définitivement en retrait. À l’automne 1968, Walter de Maria enterrait les trois salles de la Galerie Heiner Friedrich de Munich (50M 3 (1600 Cubic Feet) Level Dirt) pour faire entrer la réalité d’un paysage stérile dans le white cube. Le gazon synthétique qui recouvre le sol de RDV a lui aussi un air de catastrophe. Prélevé dans un terrain de paintball, le revêtement manifeste avec violence les effets de l’activité humaine sur l’écosystème. Une photographie circulaire révèle le site du prélèvement, le trait bleu à la peinture industrielle soulignant alors le caractère incisif du paysage. Face à l’obsolescence de la modernité, la vidéo Painting With the Soil rend encore plus sensible cette nouvelle approche du cosmos. L’artiste a fixé une toile aux parois de la fosse qu’elle a creusée à Chauvé, en Loire-Atlantique, avant d’y apposer la terre humidifiée – à la fois palette et pigment. Peinte littéralement « sur » le motif, la composition abstraite porte la trace de la touche de l’artiste, puis de ses mains, ainsi que le faisait Richard Long avec ses cercles de boue dans les années 1980 en reliant l’art gestuel à la préhistoire. En faisant avec l’environnement immédiat, Christine Laquet déplace la pratique du chevalet du côté de l’art pariétal. Elle substitue surtout la symbiose à l’anthropocentrisme, tout en faisant rejaillir la puissance de la nature. C’est en cela que l’artiste adopte une posture d’intercesseur entre les Hommes et le monde de l’invisible. Dans cette aventure, la rencontre avec chamane Sul-Wha Kim en Corée du Sud en 2011 a été décisive. C’est après avoir assisté à un rituel invoquant les esprits pour accompagner l’âme d’un mort, puis en tissant une relation de proximité avec elle, que Christine Laquet oriente son travail vers la performance, et plus précisément vers la dimension qui a popularisé ce médium : la mise en danger du corps de l’artiste. Suite à ce voyage, elle engage en 2012 une collaboration avec le performeur hollandais Robert Steijn dans laquelle les actions adoptent des formes rituelles qui visent à retrouver l’animalité en nous dans des états de transe (You Should Never Forget the Jungle, 2012). Le scénario de la pièce repose sur le rapport de séduction entre un jeune cerf et un chasseur. Dans ces mises en scène, l’objet coupant est utilisé pour sa capacité à ouvrir des espaces symboliques. Sur le bout des doigts ou masquant les yeux, la lame cherche à aiguiser le regard. Au sein de la galerie, Knife Bird # 2 (2019) est là pour nous rappeler le risque à se laisser tenter par l’expérience visionnaire, la possibilité pour le prédateur de devenir la proie. Entouré par un tapis de tiges de verre suspendues imitant les graminées, le bel oiseau mécanique exécute sa parade nuptiale dans un mouvement qui mime le vivant, à la différence près qu’il possède cinq lames de couteaux japonais en guise d’ailes et de bec. L’association de la perforation au volatile convoque autant l’imaginaire des films de Luis Buñuel ou d’Alfred Hitchcock qui reposent sur l’angoisse des yeux crevés, que celle des augures romains qui considéraient le vol et le chant des oiseaux comme des présages. Dans la continuité de cette recherche, en résidence à ARoS Kunstmuseum (Aarhus, Danemark) en 2018, Christine Laquet tente d’entrer en interaction avec un troupeau de cerfs en partageant avec eux le sommeil (Napping With A Deer), la peinture (Painting With A Deer), et la danse (Dancing With A Deer). Ces modes communication et de coexistence entre les espèces ont quelque chose de la prescience et de la prévoyance de Josef Beuys quand il se fait enfermer trois jours avec un coyote à la galerie René Block de Soho, à New York (Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me, 1974). Déplaçant les questions de la frontière entre le monde tangible et la vie invisible, le travail de Christine Laquet vise à créer avec, se laisser influencer, devenir poreux. Les mains en résine situées au fond de l’espace constituent un contrepoint à ces sérieuses considérations, une sensation de légèreté, familière aux promeneurs des champs, des jardins et des vergers de printemps. Si les moulages sur nature rappellent la pratique funéraire répandue dans les milieux bourgeois et artistiques du XIXe siècle, ces empreintes ne semblent pas s’embarrasser de faire signe. Au contraire, c’est à un lâcher-prise que nous convient ces graines suspendues de Jasmin de Madagascar, une fleur parfumée dont les crochets capturent les insectes. La dissémination de cette plante invasive nous fait sentir plus que tout la vie secrète de la nature morte, et plus encore la beauté du diable.
[1] Bruno Latour, Où atterrir ?, Comment s’orienter en politique ?, Paris, La Découverte, 2017
[2] Donna J. Haraway, Staying With the Trouble : Making Kin in the Chthulucene, Durham, Londres : Duke University Press, 2016, trad. Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin : Les éditions des mondes à faire, 2020. L’autrice vise explicitement à « raconter des histoires », remobilisant le storytelling des grands récits capitalistes pour faire émerger de nouvelles organisations sociales : des pigeons domestiques aux chenilles Monarques partageant leur nourriture avec les pucerons, afin de contrer les grands récits capitalistes.
[3] Pierre Montebello, Métaphysiques cosmomorphes. La fin du monde humain, Dijon, les presses du réel, 2015